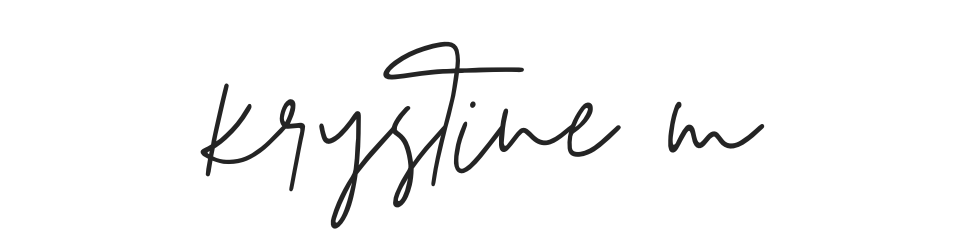Deuil périnatal : L'histoire d'Esther
Esther m’a contactée pour m’offrir de participer au Projet Humanité après avoir lu mon premier article sur le deuil périnatal. Elle disait s’être reconnue dans l’histoire de Noémie.
J’étais tellement ravie qu’elle me contacte. Il faut savoir qu’Esther et moi avons été collègues de travail pendant une courte période. Alors qu’elle était en train de vivre tout ce que je m’apprête à vous raconter, je la croisais parfois, ou j’entendais parler de ce qu’elle vivait entre les branches. Je savais qu’elle traversait une période difficile, et j’aurais voulu pouvoir faire quelque chose pour elle, mais on se connaissait peu.
Elle est arrivée chez moi un samedi, à la fin du mois de mai, alors qu’elle était de passage à Québec pour une soirée avec des amis. Il faisait gris, mais la lumière était douce, parfaite pour l’amener près de chez moi pour prendre quelques photos d’elle. Sur la route vers le fleuve, elle me racontait déjà des bribes de son histoire. Entre la lourdeur des propos qu’elle tenait, et ce que m’évoquent ses sourires sur les photos que j’ai pris d’elle cet après-midi-là, il y a tout un monde.
Esther a fait quatre fausses couches dans les dernières années. La première est survenue quelques jours seulement après la date prévue des menstruations. Elle l’avait vraiment mal pris sur le coup, mais ne se rappelle pas avoir été envahie outre mesure par cette première expérience. Sa mère lui avait expliqué que, si tôt dans une grossesse, c’était que le fœtus n’était probablement pas viable et donc, que c’était mieux comme ça. Au fil de ses grossesses, et de leurs fins précoces, elle me confie que sa mère pouvait souvent faire des commentaires maladroits, mais toujours bienveillants, qui tendaient à normaliser ses fausses couches. Entre normaliser et banaliser, la ligne est parfois mince. Au fond, elle ne saisissait simplement pas l’ampleur de ce que sa fille vivait, jusqu’à ce qu’une amie le lui explique. À partir de là, elle a commencé à écouter davantage et est devenu une source de soutien importante pour Esther.
La deuxième fausse couche a laissé une marque beaucoup plus profonde. Son premier rendez-vous de suivi était prévu pour le 19 décembre, juste avant les fêtes. Elle était enceinte de 10 semaines. Son conjoint et elle avaient hâte d’entendre et de voir leur bébé.
Sa médecin a cherché un battement de cœur, en vain.
Elle a envoyé Esther en écho d’urgence le jour même, utilisant toutes les ressources qu’elle avait à sa disposition pour ne pas la faire attendre. C’est d’ailleurs un élément important dans l’histoire d’Esther. À plusieurs reprises, elle répète comment elle a eu de la chance d’avoir cette médecin-là à ses côtés. Elle avait la particularité d’avoir vécu elle-même plusieurs fausses couches et de connaître et comprendre les défaillances du système de santé pour gérer ce type d’événement. Elle anticipait donc chaque étape pour lui éviter d’attendre inutilement. Elle était transparente, ne lui faisant jamais de faux espoirs, mais se montrant soutenante à la fois. Elle était humaine et dévouée. Tout ce qui devrait être la base de la pratique médicale.
C’est une technicienne qui a fait l’échographie. Elle ne pouvait donc pas donner les résultats à sa patiente, même si elle savait visiblement ce qu’elle avait devant les yeux. Il fallait attendre le médecin.
«Mais je le savais. Je le voyais dans son visage, dans son nom verbal. Pendant que mon chum était encore dans la nervosité et l’espoir, moi, je me préparais déjà à faire mon deuil.» Comme de fait, le médecin de garde lui confirme que le cœur de son bébé a arrêté de battre.
Cette première échographie lui a dérobé le bonheur de l’anticipation de la première rencontre avec bébé pour ses grossesses suivantes.
«Ça m’a vraiment marqué. C’était tellement injuste, j’avais l’impression que ma vie, la vie de mon bébé, s’était jouée sur un coup de dés. Comme si tout aurait pu se passer autrement cette journée-là. Je me suis rendu compte que je n’avais pas le contrôle sur grand-chose là-dedans, ce qui a été difficile à accepter.»
La nouvelle annoncée, on lui propose de prendre de la médication ou de faire un curetage pour expulser le fœtus. On encourage toutefois Esther à prendre la médication, ce qu’elle accepte. Après tout, l’idée de pouvoir vivre ça chez elle, plus naturellement, est moins difficile à accepter que celle d’une intervention médicale au bloc opératoire. Malheureusement pour elle – ou heureusement, comme on le verra plus tard - la médication n’a pas fonctionné.
Retour à la case départ.
On l’envoie donc faire un curetage. Or, tout ce qui sort d’une salle d’opération est analysé. C’est grâce à ces analyses qu’Esther a su qu’elle faisait une môle partielle, qui n’avait pas été décelée à l’échographie, et qui expliquait sa fausse couche.
La môle partielle est un type de maladie gestationnelle trophoblastique bénigne qui affecte environ 1 grossesse sur 1000. Elle est due à des anomalies dans la fécondation de l’ovule par le spermatozoïde, ce qui amène le placenta à se développer de façon anormale. Bien que la môle soit une maladie bénigne, si des tissus affectés restent dans l’utérus, elle peut évoluer en cancer.
C’est sur ses lieux de travail qu’Esther apprendra cette nouvelle. Alors qu’elle était retournée travailler dans l’intention plutôt inconsciente, croit-elle, d’engourdir sa peine, elle se fait vite rattraper par la réalité. On lui explique qu’elle devra passer des prises de sang chaque semaine jusqu’à ce que son taux d’hormones de grossesse soit à 0, afin de s’assurer qu’aucun tissu anormal n’est resté en place après le curetage. Heureusement, ses hormones reviennent vite à 0. Et elle est en mesure de retomber enceinte rapidement.
«C’était vraiment important pour moi de retomber enceinte le plus vite possible. J’avais cette idée fixe en tête. Probablement pour tout éteindre ce que je venais de vivre… Recommencer à zéro, tout effacer, surement que ça avait quelque chose de rassurant...»
Après avoir fait une môle, les grossesses suivantes sont étroitement surveillées et la première échographie est faite tôt pour s’assurer qu’il n’y ait aucune anomalie. C’est comme ça qu’au début de sa troisième grossesse, une échographie précoce a révélé un œuf clair. Elle avoue qu’elle ne comprend toujours pas totalement ce que ça veut dire. Reste qu’elle avait à nouveau un choix à faire : médication ou curetage?
«Pour moi, c’était clair, ça allait être un curetage. Même si les médecins poussent toujours la médication pour éviter une intervention, j’avais compris ce que je gagnais en ayant les tissus retirés analysés – et ce que je perdais si on passait à côté de quelque chose de potentiellement grave.»
Deuxième curetage. Cette fois-là, l’anesthésiste fait une erreur et le processus d’endormissement est souffrant. Contre toute attente, Esther rit en se remémorant le visage de sa médecin, si attentionnée, qui allait effectuer le curetage cette fois-là. «À voir son expression, elle a dû lui parler dans le casque quand je me suis finalement endormie!»
Elle se réveille en salle postopératoire dans le même état dans lequel elle s’est endormie : en panique et en pleurs. On la laisse partir, malgré tout, avec une feuille sur laquelle sont écrites les précautions à prendre et les ressources à appeler en cas de complications d’ordre physiologique. Rien sur le support psychologique.
«C’est drôle… quand tu demandes un avortement, tu es obligée de voir une travailleuse sociale pour discuter des raisons de ta décision et avoir le support nécessaire. Pourquoi, quand on fait une fausse couche, aucun soutien n’est donné par défaut?»
Après le curetage, à nouveau, les prises de sang pour s’assurer que les hormones redescendent. Trois semaines plus tard, Esther apprend plutôt que ses hormones montent et que les analyses ont révélé des cellules cancéreuses dans les tissus retirés. Il pourrait s’agir d’une tumeur trophoblastique, une complication possible de la môle. C’est là que pour elle, le véritable cauchemar a commencé.
Rapidement, une nouvelle échographie est prévue, et on détecte une boule d’une dizaine de millimètres dans son utérus. On l’envoie faire un troisième curetage le jour même, qui permettra d’envoyer des tissus pour des analyses plus poussées. Le curetage est aussi la première étape à suivre dans le cas de ce type de tumeur. Un coup d’avance pour la médecin de Esther. Et heureusement. Car en temps normal, les résultats d’analyses pour ce type de tests prennent environ trois semaines à arriver. On est en 2021, en pleine pandémie de COVID-19. Le système de santé au complet fonctionne au ralenti. Esther attendra ses résultats pendant trois mois.
«Je suis tombée en profonde dépression. Le fait de ne pas pouvoir me battre tout de suite contre quelque chose qui grandissait peut-être en moi était excessivement difficile.» La sensation de perte de contrôle à nouveau. La peur, la peine, mais surtout la colère, la submerge et la paralyse. Toutes les émotions négatives qu’elle évitait de vivre après sa deuxième fausse couche ont refait surface. Elle ne se reconnaissait plus. C’est là qu’elle a vécu son deuil.
Pendant cette période, elle a eu de la difficulté à être présente et soutenante pour ses amies qui parfois vivaient des situations similaires à la sienne. Elle s’est rendu compte que ça la ramenait dans son propre vécu. C’était trop souffrant. Elle a dû apprendre à respecter ses limites. Alors qu’elle s’occupait toujours des autres, elle a dû apprendre à se prioriser. C’était difficile pour elle, mais ses amies comprenaient.
Alors qu’elle allait amorcer une démarche en psychologie pour faire le ménage dans tout ça, elle a reçu les résultats de ses analyses.
Négatif. Tout est normal. Il n’y a pas de cancer.
Malgré le soulagement, elle débute son suivi, consciente de l’importance de ne plus nier ce qu’elle vie intérieurement. «C’était la meilleure décision. Le fait de prendre cette heure-là, chaque semaine, m’a appris que je pouvais, et que je devais, prendre du temps pour moi. Je me suis mise à aller prendre des marches, à lire sur le bord d’un lac. J’ai apprivoisé la solitude et les émotions qui remontent quand on se retrouve seule. Ça m’a vraiment fait du bien de ralentir. De me dire que j’avais le droit, de juste m’arrêter pour regarder ce qui m’entoure.» Sa colère a diminué graduellement.
Après coup, elle était moins pressée de retomber enceinte. Mais ça n’a pas vraiment tardé. Cette fois-là, elle et son conjoint ne se donnent pas le droit de se réjouir. Pas tout de suite.
À nouveau, une échographie précoce… qui montre un sac gestationnel vide. Elle est envoyée en curetage pour une troisième fois. Cette fois, au moins, ça se passe bien.
Un mois plus tard, voyant qu’elle n’a toujours pas de menstruation, elle consulte à nouveau sa médecin qui décide finalement de lui refaire un curetage - à l’éveil cette fois - puisqu’il reste des débris dans son utérus.
«C’était horrible. Un vrai cauchemar. Pendant l’intervention, je faisais comme si ça allait, comme d’habitude. Mais ça faisait extrêmement mal. Et quand je suis sortie de la salle, j’ai fait un choc vagal. Une chance que ma mère était là pour s’occuper de moi.» Plus jamais elle n’acceptera de faire un curetage sans anesthésie, même si on l’y encourage.
2022. Plusieurs mois ont passé depuis son dernier curetage. Esther est en retard sur ses règles. Elle sait qu’elle est enceinte, elle le sent, mais elle retarde tout. Le test de grossesse, l’annonce à son conjoint, l’appel à l’hôpital, la première échographie. Elle ne veut plus se mettre la pression. Inévitablement, elle se rend à l’évidence qu’elle va devoir amorcer son suivi médical et faire face à ce qui se présentera à elle.
Pour la première fois depuis le début des mesures drastiques pour prévenir la propagation de la COVID-19 en milieu hospitalier, son conjoint peut venir avec elle à l’échographie. Étrangement, elle ne se sent pas pessimiste comme à l’habitude. Elle est à 6 semaines de grossesse lorsque la technicienne, qu’elle reconnait d’une de ses visites précédentes, pose la sonde sur son ventre.
Aussitôt, un point clignote sur le moniteur. C’est le cœur de son bébé qui bat. Esther n’en revient simplement pas, et son conjoint non plus.
Elle me montre la photographie de l’échographie. La première pendant laquelle ils auront reçu de bonnes nouvelles. On y voit une petite tâche en forme de cacahouette. «La majorité des gens vont tripper sur la photo de l’échographie de 10-12 semaines, où on voit vraiment un bébé tout formé. Moi, c’est celle de 6 semaines ma préférée. Pour moi, c’est cette image-là qui est la plus pleine de sens.» C’est l’image qui a brisé le cycle, alors qu’elle commençait à se faire à l’idée qu’elle n’aurait peut-être jamais d’enfant.
Depuis cette échographie-là, les bonnes nouvelles continuent d’affluer pour leur bébé à naître. Chaque nouvelle échographie les apaise, elle et son conjoint, mais c’est toujours de courte durée. La suivante est à nouveau source d’angoisse, de doute. Ils ne tiennent plus rien pour acquis.
Si c’était à refaire, Esther ne changerait rien.
«Ça peut paraître bizarre, mais je le revivrais de la même manière. Parce que oui, actuellement, à chacun de mes rendez-vous, je vis de l’anxiété. Mais sans ces évènements-là, je pense que je ne réaliserais pas, aujourd’hui, à quel point ce que je vis est précieux. En ce moment, mon chum et moi, on est tellement dans le moment présent, et on est tellement reconnaissants de tout ce qui se passe. Et ça m’a fait grandir énormément. J’ai réalisé que j’avais toujours plein de choses dans mon horaire, mais que j’étais toujours en train de penser à la chose suivante à faire sur ma to-do list, sans jamais vraiment savourer ce que je vivais là, aujourd’hui. Maintenant, je m’arrête. J’apprécie ce que je vis, ce que j’ai. Et j’apprends à apprécier le fait que je sois juste un être humain, qui a le droit d’être vulnérable. On ne peut pas toujours encaisser, être inébranlable.» Il faut se donner le droit d’avoir des failles et rentrer dedans tête baissée pour pouvoir grandir.
Depuis 23 semaines, son bébé grandit avec elle.