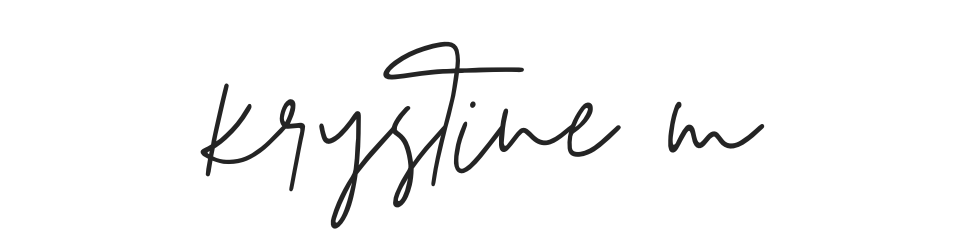Deuil périnatal : L'histoire de Dominique
Dominique m’a accueillie comme elle accueille tout le monde chez elle : comme un membre de sa famille. J’avais prévu trois heures pour ma rencontre avec elle, on en a pris le double. Elle a même repoussé un rendez-vous pour parler plus longuement. Pendant les six heures que je passe chez elle, des gens cognent à sa porte pour lui dire bonjour ou la saluent dans la rue, et elle prend toujours le temps pour prendre des nouvelles, pour jaser un peu.
C’était un objectif de vie, pour elle, d’avoir une grande famille. Elle se voyait avec quatre ou cinq enfants, elle voulait une grande tablée. Elle en a eu deux, Charlotte et Lilou, et espère en avoir un troisième sous peu. Mais Dominique croit que le besoin d’avoir une grande famille peut être comblé de plusieurs façons. Pour elle, c’est important de prendre soin de ses filles et de son conjoint, mais aussi de prendre le temps pour ses amis et leurs enfants, pour ses voisins, et même pour les animaux qui croisent son chemin. «Il y a tellement de façons d’être mère.»
Après nous avoir fait un thé, on s’assoit pour jaser de ses expériences de vie. Son gros bouvier bernois vient nous rejoindre, réclamant de l’amour à sa maîtresse avec qui il est visiblement fusionnel. Dominique me dira plus tard que dans les derniers mois, son chien a été une source de support inestimable. Elle a perdu son père de la maladie, et son conjoint a perdu sa sœur dans des circonstances tragiques. Dernièrement, elle a aussi fait une fausse couche, sa troisième. Au fil des heures passées avec elle, je me rends compte que le parcours de Dominique est parsemé d’embûches qui auraient pu l’amener à se refermer sur elle-même. Impossible, pourtant, de deviner les souffrances qu’elle a endurées en voyant son sourire rayonnant lorsqu’elle m’accueille chez elle, un lundi matin gris de mai.
Lorsqu’elle avait environ 15 ans, Dominique a appris qu’elle faisait de l’endométriose sévère. Chaque mois, ses menstruations étaient extrêmement douloureuses, au point de l’amener au bord de l’évanouissement. Le gynécologue qu’elle avait rencontré lui avait alors dit qu’avec sa condition, les risques d’infertilité étaient très importants. Ça l’a marquée.
À la fin de l’année 2013, elle et son conjoint, Matthias, décident d’arrêter la contraception. À peine un mois plus tard, le petit «+» tant attendu apparaît. La joie était d’autant plus grande que cinq années d’essais infructueux avec un précédent conjoint avaient au départ semblé vouloir confirmer les pires craintes de Dominique. La vie avait simplement d’autres plans pour elle.
Treize semaines passent, sa grossesse se déroule bien. Au mois de février 2014, alors qu’elle se produit au théâtre pour la Saint-Valentin, elle commence à avoir des saignements légers. «Je suis allée voir ma sage-femme pour me calmer, me raisonner. Mais des fois, tu le sais, on a comme un feeling…»
Le lendemain, lors de la deuxième représentation de la pièce de théâtre, alors qu’elle est seule sur scène, elle se rappelle avoir senti qu’elle perdait son bébé : «Je le sens passer. Je perds littéralement mon bébé sur scène. Je me suis dépêchée de terminer mon monologue et je suis allée à la salle de bain. J’ai vu alors que je l’avais vraiment perdu.» Dominique est retournée faire la finale du spectacle, puis elle est repartie chez elle, une sensation de vide à l’intérieur.
Elle s’est rendue à l’urgence le lendemain. Les douleurs persistaient, amplifiaient. Elle raconte tout à l’infirmière du triage, qui lui répond de ne pas s’en faire avec ça, puisqu’une grossesse sur quatre se termine en fausse couche. Elle ajoute que ce n’est pas grave, qu’elle aura simplement un autre bébé. La seconde infirmière qu’elle voit pour ses prises de sang lui martèle aussi la statistique censée la rassurer.
Dominique a senti qu’on invalidait sa peine. «Parce que c’est fréquent, je ne devrais pas avoir de peine? Est-ce qu’on va dire ça à quelqu’un qui a un diagnostic de cancer, qui perd un proche dans un accident de voiture, ou qui se sépare? Que selon les statistiques, ça arrive souvent, donc ce n’est pas si grave que ça? Et de me faire dire que j’en aurai un autre… Qu’est-ce qu’elle en sait? Avec mon historique médical, ma fausse couche impliquait plus que perdre un bébé, elle impliquait aussi la possibilité que je ne puisse peut-être jamais mettre un enfant au monde.»
Je lui ai demandé ce qu’elle aurait voulu qu’on lui dise. «Le plus important, c’est juste d’entendre et de reconnaître la peine, malgré la statistique. Reconnaître que c’est de la marde. Après, ça te donne l’espace et le droit d’aller t’en occuper chez toi, de décortiquer tout ça avec tes proches ou des ressources d’aide.» Encore faut-il que ces ressources soient offertes et disponibles. Dans son cas, aucun des professionnels rencontrés ne lui en a proposé.
Après le triage, on lui fait voir un médecin résident. Avant même de l’avoir auscultée, il énumère à voix haute les différents scénarios pouvant expliquer les saignements : grossesse ectopique et caillot de sang, grossesse multiple et perte d’un des fœtus… Il a presque l’air de réviser pour un examen. Ces paroles suscitent de faux espoirs et de nouvelles inquiétudes chez Dominique. «Après ça, pendant qu’il m’auscultait, il m’a carrément montré sa main recouverte de sang en disant : ouin, tu saignes pas mal, c’est probablement que tu le perds. Il me dit ça comme si de rien n’était, alors que je suis sur la table en train de pleurer.» Des vraies montagnes russes d’émotions dans un environnement où, bien souvent et dans ce cas-ci, on ne les reconnaît ni ne les adresse.
Après avoir été renvoyée dans la salle d’attente pour plusieurs heures, le dernier médecin qu’elle rencontre lui confirme sa fausse couche et lui dit de retourner chez elle se reposer. C’est plus tard que Dominique a su, par sa sage-femme, qu’une échographie de contrôle aurait dû être prescrite dans les jours qui ont suivi.
Il arrive qu’après une fausse couche naturelle, des tissus organiques restent dans l’utérus, le plus souvent, des débris placentaires. S'ils ne finissent pas par s'éliminer d'eux-mêmes, il faut intervenir médicalement ou chirurgicalement pour éviter tout risque de complication (infection, hémorragie, infertilité). Aucun suivi n’a été fait.
Dominique a eu la chance de retomber enceinte rapidement, ce qui indique que son corps avait réussi à faire son travail. Mais elle ne peut s’empêcher de penser aux conséquences qui auraient pu arriver dans le cas contraire. Surtout avec sa condition médicale.
Au cours de cette journée à l’urgence, mise à part une autre patiente assise face à elle dans la salle d’attente, personne ne lui a demandé comment elle allait. Personne ne lui a offert de médication pour la douleur, ou de serviette hygiénique pour ses saignements. Elle s’est tortillée sur sa chaise pendant 7h. C’est ce qu’elle a trouvé le plus violent dans cette expérience-là. Le manque d’attention pour son bien-être, non seulement physique, mais aussi psychologique.
Dominique travaille en intervention auprès de populations vulnérables et elle termine actuellement sa maîtrise en travail social. Elle est donc outillée pour poser un regard critique sur le traitement reçu et les paroles entendues dans cette expérience. Son entourage supportant lui a permis, comme elle l’a dit, de décortiquer ce qu’elle a vécu par après, de limiter les dommages collatéraux. Néanmoins, son expérience a eu un effet néfaste sur ses grossesses suivantes.
Après la peine, c’est la peur qui s’est emparée d’elle. En 2014, quand elle est tombée enceinte une deuxième fois, elle craignait constamment de perdre à nouveau son bébé. Sa sage-femme l’a beaucoup aidée à adresser ses peurs. «Elle les accueillait avec bienveillance et ça a fait toute la différence. Je pouvais aller à la maison de naissance quand je voulais pour entendre le cœur de mon bébé.» Cet accueil lui permettait de faire baisser son anxiété, de se sentir écoutée.
Charlotte est née prématurément, à 34 semaines de grossesse. Dominique n’a pas pu accoucher en maison de naissance comme elle le voulait. Fréquemment, les larmes lui montent aux yeux en racontant les violences obstétricales qu’elle a vécues pendant son accouchement en milieu hospitalier.
La violence obstétricale fait référence à une déshumanisation des soins, par la perpétration d’actions posées sans le consentement éclairé des femmes. On peut aussi parler de comportements abusifs, de négligence, de mauvais traitements, de manque de respect, pouvant occasionner des traumatismes physiques, sexuels, moraux ou psychologiques. [1] Malheureusement, le cas de Dominique n’en est pas un isolé, et ces pratiques sont de plus en plus dénoncées.
J’ai hésité à raconter cette partie de l’histoire de Dominique. Malgré le fait que ça ne concerne pas directement le sujet du deuil périnatal, je pense que le traitement dont elle a été victime est au cœur de ce qui est problématique dans la manière d’adresser les fausses couches en milieu hospitalier. Ce qu’elle a vécu met en lumière une approche froide, expéditive et non personnalisée, qui engendre des conséquences sérieuses et évitables. Pour Dominique, les blessures semblent toujours vives.
Je n’ai aucun doute que certains intervenants sont bienveillants, attentifs et respectueux. Qu’ils tentent d’amener un peu d’humanité dans leur milieu de travail et leurs pratiques. Mais beaucoup de travail reste à faire pour que ces efforts se traduisent par de réels changements, dans un système qui semble défaillant à la racine.
Dominique a fait deux autres fausses couches, lesquelles elle a pu, par chance, vivre chez elle. C’était plus doux, même si la peine était à chaque fois présente. Toutefois, ces grossesses interrompues, plus précoces que la première, sont plutôt restées sans échos de la part de ses proches qu’elle sentait moins soutenants. «Peut-être parce que j’avais déjà un enfant, ou que c’était arrivé plus tôt. Peut-être aussi parce que la grossesse n’était pas prévue…» Ils avaient l’air de trouver ça moins grave… ça se sentait dans leurs mots, leur ton. Les réflexions étaient plus cartésiennes, logiques, rationnelles. Comme à l’hôpital cette fois, ses émotions étaient mises en second plan.
Même de son côté, Dominique prend conscience qu’elle parle davantage de ces deux autres interruptions de grossesse avec détachement. Elle admet qu’elles l’ont moins affectée que la première. Mais elle ne voudrait jamais renvoyer le message à quelqu’un que sa fausse couche est «moins pire» qu’une autre. Selon elle, chaque fin de grossesse imprévue devrait être traitée comme ce qu’elle est : la perte d’un enfant, même si cet enfant-là est encore au stade d’idée, de rêve. L’important, c’est comment on vie l’expérience individuellement, comment on la ressent. Et cette façon de la vivre et de la ressentir dépend d’un grand nombre de facteurs internes et externes propres à chacun. Des facteurs dont on n’a pas nécessairement conscience, qu’on soit des proches ou des professionnels de la santé, si on ne s’attarde pas à poser des questions et à écouter.
Sans idées préconçues, sans comparer, sans chercher à comprendre ou normaliser à tout prix.
Il suffit d’écouter.
-
Référence:
[1] PITRE, Marie-Christine (2020) - Qu’est-ce que la violence obstétricale? http://www.orfq.inrs.ca/javais-limpression-de-navoir-aucun-controle-quest-ce-que-la-violence-obstetricale/
Ressources pour le deuil périnatal :
Québec : https://www.lesperseides.org/